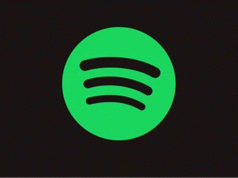Aujourd’hui, la nomination à un poste de management ne fait plus automatiquement le manager. Cela serait notamment une des conséquences de la crise de l’autorité. Le costume et les gallons ne font plus, à eux seuls, le manager. Statut n’est plus synonyme de légitimité. Cette dernière n’est plus une donnée, mais un construit, social notamment.
On n’est pas manager, on le devient !
Hier, après avoir été nommé, il ne restait plus au manager qu’à acquérir une poignée de compétences en formation. Il n’en va plus de même aujourd’hui. On n’est plus manager, on le devient ! Il faut ainsi changer de paire de lunettes pour penser le management et appréhender le manager. Là où les raisonnements étaient statiques et centrés sur le contenu (les compétences à posséder pour être un manager), ils doivent dorénavant être dynamiques et construits à partir du processus de transformation (comment on devient un manager).
Une analogie à la parentalité
Dans Le manager idéal n’existe pas !, j’ai imaginé, il y a quelques années déjà, le terme « managérialité » pour nommer le processus par lequel une personne devient manager. Au moment de la naissance d’un premier enfant, soudainement, on devient père ou mère. L’enfant est là, il faut s’en occuper. Mais y est-on prêt ? Combien de temps faut-il pour l’être réellement ? Il y a une différence entre avoir un enfant et être parent. C’est la même chose en matière de management. On se voit confier des responsabilités managériales du jour au lendemain. Mais, à coup sûr, on ne devient pas immédiatement manager. Surtout dans le contexte actuel.
On ne devient plus manager par décret, pour plagier l’expression célèbre de Michel Crozier sur le changement. La managérialité est un processus de transformation qui débute avant et qui se poursuit longtemps après la nomination.
Les 4 dimensions de la managérialité
En plus de sa dimension organisationnelle (nomination et délégation d’une autorité statutaire), ce processus en comporte trois autres. La deuxième dimension est culturelle. Le management ne s’exerce jamais dans l’absolu, toujours au sein d’un contexte fait de plusieurs cultures enchevêtrées les unes aux autres : nationale, de métier, d’entreprise,… Devenir manager nécessite d’intérioriser un système de valeurs et de croyances, et de se conformer à un ensemble de normes de comportement. Cela, le manager l’apprend avec le temps, même sans en avoir conscience. C’est au moment d’un changement, d’entreprise en particulier, qu’il s’aperçoit que codes et manières d’être diffèrent, et que l’exercice de sa fonction nécessite l’apprentissage de nouvelles pratiques.
On devient manager aussi dans le regard des autres
La troisième dimension de la managérialité est sociale. Le manager exerce sa fonction au sein d’un réseau de relations : N+1, N-1, pairs, services fonctionnels,… On devient manager aussi, et peut-être avant tout, dans le regard des autres. Là aussi, les coutumes varient, mais le titre, seul, ne fait plus le manager. Sans un minimum de pouvoir personnel, celui que ses collaborateurs lui reconnaissent, le manager ne peut user du pouvoir institutionnel, celui qui est attaché à sa fonction, celui que l’institution pour laquelle il œuvre lui a délégué. Ce processus de légitimation passe par l’acceptation, toujours plus ou moins explicite, du manager par les parties prenantes à l’exercice de sa fonction. Sans légitimité, point d’autorité. Et sans autorité, pas de manager !
Etre au clair avec son ego
Enfin, la dernière dimension est psychologique. Etre un manager nécessite de posséder certaines ressources intrapsychiques requises par l’exercice de la fonction. Par exemple, pour faire faire, essence du travail de management, le manager doit changer ses habitudes, mais aussi, être au clair avec son ego. Il lui faut accepter qu’un de ses collaborateurs puissent faire mieux que lui, supporter de ne pas être irremplaçable,… Il doit renoncer à sa toute puissance, passer du stade de l’indépendance à celui de l’interdépendance disent les psychologues.
Il y a toujours beaucoup de fausses bonnes raisons de continuer à faire soi-même : « je le ferai plus vite moi-même ; cela sera mieux fait si c’est moi qui le prend en charge ; je suis seul à en être capable ; si je ne le fais pas moi-même, je vais perdre mon pouvoir ; la reconnaissance va m’échapper ; etc. » Un bon manager, dit-on couramment, c’est quelqu’un qui n’hésite pas à recruter des personnes « meilleures » que lui. Cela exige une confiance en soi suffisante pour ne pas se sentir menacé par quelqu’un qui possède des compétences qu’on n’a pas.
Le premier ennemi du manager, c’est sa propre culpabilité
Reste la question de l’autorité ! Son exercice ne va pas de soi. Il faut en être capable, au sens psychologique du terme, ne pas avoir trop de choses à se reprocher. Sans quoi, par culpabilité, on l’exerce mal, à moitié ou par défaut. Le premier ennemi du manager, c’est sa propre culpabilité. Le syndrome de l’usurpateur le guette toujours de près ou de loin. Y compris quand il est au clair avec lui-même, faire la différence entre être respecté et être aimé, entre construire des relations de coopération et des relations amicales,… n’est pas immédiat.
Il faut du temps pour admettre qu’un désaccord sur ses idées n’est pas forcément une atteinte, voire une remise en question de son autorité. Le manager doit apprendre que ses collaborateurs peuvent avoir un point de vue différent du sien ; qu’en l’exprimant, ils cherchent à lui faire part de leur opinion, pas forcément à remettre en cause son autorité. A l’opposé, il peut confondre autorité et autoritarisme. Il devient alors un autocrate, quelqu’un qui domine les autres, qui cherche à écraser ses collaborateurs avec les dégâts psychologiques que l’on connaît.