Avant de s’égarer au milieu des années 1980, la pensée organisationnelle a connu quatre grandes étapes de développement sur lesquelles il est possible de recommencer à capitaliser pour permettre aux entreprises d’entrer de plain-pied dans le XXIème siècle. Explication !
Etape N°1 : L’organisation comme facteur de performance
Au début du XXème siècle, quelques pionniers, dont Frederik Taylor et Henri Fayol, ont fait de l’organisation un facteur de performance. On admet alors que la performance d’une entreprise ne résulte pas seulement des compétences et de la motivation de ses salariés. Au savoir-faire et au vouloir-faire s’ajoute le pouvoir faire. L’organisation devient un sujet digne d’investissement intellectuel.
L’organisation permet à un groupe de personnes d’obtenir une performance supérieure à celle que chacune aurait pu obtenir seule. Comment ? En assignant des rôles différents et complémentaires, c’est-à-dire en divisant le travail. Une fois divisé, pour atteindre un but commun, le travail doit être coordonné. L’organisation est depuis lors pensée comme la conjonction de deux processus : division et coordination du travail.
Etape N°2 : L’organisation, ça dépend
Pour la plupart ingénieurs, les pionniers ont abordé l’organisation comme une machine et espéré découvrir les lois universelles de son fonctionnement en s’appuyant sur les sciences. C’était un fantasme ! Il a fallu attendre les années 1960 pour renoncer à la quête du « one best way » des fondateurs et admettre que l’organisation idéale ne pouvait pas exister.
Le principe de la contingence permet de comprendre que, en matière d’organisation, « ça dépend » des caractéristiques de l’entreprise et de son environnement. Il s’agit alors d’établir des correspondances entre modalités organisationnelles et caractéristiques de contextes d’actions particuliers. Dans quels cas de figure une organisation décentralisée est-elle pertinente ? Dans quels autres, au contraire, une organisation centralisée est plus adaptée ? Chaque organisation présente des avantages et des inconvénients lesquels varient en fonction d’un contexte d’action particulier.
Etape N°3 : L’organisation comme système
Dans la foulée, grâce à l’émergence d’une approche transdisciplinaire sous la houlette de Ludwig Von Bertalanffy, l’entreprise est appréhendée comme un système, c’est-à-dire comme un ensemble d’unités interagissant pour atteindre un but particulier. L’organisation, elle, caractérise l’agencement des interactions entre les unités du système que constitue toute entreprise.
On comprend alors que, les unités étant liées les unes aux autres, elles ne peuvent être appréhendées isolément les unes des autres. Par ailleurs, l’organisation constitue un tout qui, grâce à un phénomène dit d’émergence, présente des propriétés propres que ne possède aucune de ses parties. L’organisation n’est pas seulement un agrégateur de performances individuelles mais bien un créateur de performance collective.
L’homéostasie, liée à des rétroactions négatives, produit le minimum de stabilité dont a besoin toute organisation ; le changement, lui, est issu d’une succession de rétroactions positives. Enfin, grâce à William Ross Ashby et sa fameuse loi dite de la variété requise, on comprend que, pour être performante, une organisation doit permettre à un système d’adopter un nombre d’états au moins aussi important que celui de son environnement.
Etape N°4 : L’organisation comme construit social
Enfin, le dernier moment décisif du développement de la pensée organisationnelle apparaît quand on appréhende l’organisation comme une réponse à un problème d’action collective, c’est-à-dire comme un construit social, un système d’action concret disent Michel Crozier et Erhard Friedberg. On prête alors attention aux interactions de fait entre les entités, celles qui existent dans la « vraie vie », et non celles qui devraient théoriquement exister. Cela permet notamment de dépasser la distinction entre dimensions formelles et informelles de l’organisation et de comprendre que cette dernière est, par une causalité circulaire et non linéaire, à la fois l’effet et la cause des interactions réelles.
Grâce entre autres aux travaux du prix Nobel d’économie Herbert Simon, on admet que les rationalités organisationnelles sont limitées et non absolues. On accepte alors l’idée que, en matière d’organisation, il n’y a pas d’optimum mais seulement des solutions plus ou moins satisfaisantes au regard des attentes des parties prenantes. On comprend également que, grâce à la différence entre ce qu’elle produit et ce qu’elle consomme, l’organisation constitue des réserves qui la dote d’une certaine autonomie.
Quand la pensée organisationnelle s’égare
Depuis le milieu des années 1980, la pensée organisationnelle s’est à la fois considérablement enrichie et, en même temps, dispersée et égarée. La recherche d’opérationnalité a cédé la place à une quête effrénée d’exhaustivité. Un fossé s’est alors creusé entre les préoccupations du monde académique et celles des opérationnels dans les entreprises.
Du coup, face aux problèmes d’organisation, les dirigeants sont aujourd’hui un peu livrés à eux-mêmes, délaissés par un monde académique qui n’est plus en prise avec leurs problématiques. Ils s’en remettent alors à leur GBS (Gros Bon Sens) parfois en réinventant la roue, le plus souvent en « prenant la carte pour le territoire », c’est-à-dire en réduisant l’organisation à un organigramme. Ils modifient des cases et des lignes sur des feuilles de papier, produisent des Slides de plus en plus nombreux et colorés, sans que l’agencement des interactions réelles, celui qui constitue l’organisation, n’évolue pour autant.
Ou bien les dirigeants se jettent sur les premiers évangélistes venus vantant les mérites de nouveaux modèles organisationnels prétendument révolutionnaires, comme celui de l’entreprise libérée par exemple, qui contreviennent aux acquis les plus basiques de la pensée organisationnelle et qui, heureusement, ne font pas long feu face à l’épreuve des faits.
Il est temps de remettre l’ouvrage « Organisation » sur le métier en recommençant à capitaliser sur les acquis de la pensée organisationnelle. Cela sera le sujet d’un billet à venir.


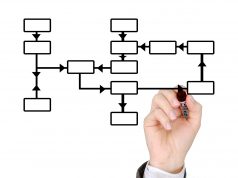


[…] Les connaissances permettant de retravailler le sujet existent et sont disponibles (voir mon billet à ce sujet). Il faut leur redonner leurs lettres de noblesse pour permettre aux managers en […]